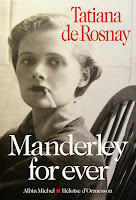Caroline R, qui prépare un master sur Peter Pan m'a adressé un questionnaire auquel j'ai répondu un peu hâtivement.
Pourquoi avoir accepté de traduire Peter
Pan ?
Je n’ai pas « accepté » de traduire
Peter Pan, je l’ai proposé à l’école des loisirs pour lequel j’avais déjà
effectué un certain nombre de travaux. Peter Pan est sans doute l’une des
grandes frustrations de mon enfance, attiré par l’univers que développait
Disney, je n’ai jamais réussi à voir son film, c’est l’apparition des
magnétoscopes qui m’a permis d’enfin le visionner. Je ne l’ai lu que
tardivement, devenu jeune professeur,et j’ai été frappé par la richesse de
l’écriture.
Qu’est-ce que la traduction de Peter Pan présente comme difficulté particulière ?
Et bien, comme Barrie s’amuse avec son lecteur, de ses personnages, de son
univers, il joue aussi avec le langage, transforme des noms en verbes, utilise
parfois des expressions régionales. Tous ces écarts m’ont posé problème,
d’autant que je n’ai pas une formation d’angliciste mais une formation de
lettres modernes. Pour excuser mon incompétence, j’ai l’habitude de dire que la
littérature n’a pas de frontière. Et puis, Giono a bien traduit Moby Dick.
Des traductions préalables de l’œuvre existaient,
en quoi la vôtre diffère-t-elle ? En quoi une nouvelle traduction de
l’œuvre était-elle nécessaire ?
Il y a bien des traductions de Peter Pan, trois
d’entre-elles m’ont été utiles
Celle d’Yvette Métral chez Flammarion, celle de
Michel Laporte au livre de Poche et celle d’Henri Robillot pour Gallimard. La première est,
par moment, inspirée mais elles présente des contre-sens fâcheux. La seconde
est une traduction quasiment littérale et son français manque singulièrement de
naturel. La dernière est une traduction littéraire, souvent recherchée mais qui
s’éloigne considérablement du texte d’origine.
J’ai donc voulu éviter les trois écueils
précédents.
Que désiriez-vous souligner dans cette nouvelle
traduction ?
J’aurais aimé atteindre à cette dimension ludique
que Barrie met en œuvre mais c’était impossible, à défaut, j’ai cherché la
fidélité à l’idée. Neverland par exemple est devenu le Pays-Hors-Du-Temps, ce
qui me semble plus fidèle que « Pays Imaginaire » ou « Pays de
Nulle Part », l’adverbe "never" nous renvoyant au temps, pas au lieu.
A quel lectorat votre traduction
s’adresse-t-elle ? Quel lecteur aviez-vous en tête lorsque vous projetiez
de traduire Peter Pan, lorsque vous le traduisiez effectivement, et après
l’avoir traduit ?
Au lectorat de Tintin, de 7 à 77 ans. Je ne me
suis pas posé la question pour être honnête. Je crois qu’un texte littéraire
doit être traduit en tenant compte des effets qu’il suscite dans la langue d’origine. Les Misérables conviennent aussi bien à des 4e qu’à des
étudiants de licence. Lorsque j’ai adapté Gilgamesh, destiné à des 6es, j’ai
avant tout cherché à rendre la petite musique que rend le texte antique. C’est
un texte que d’aucuns trouveront dur pour des 6es, je crois simplement qu’il
respecte son lectorat.
Le site internet de l’Ecole des loisirs adresse Peter
Pan à un lectorat âgé de 9 à 12 ans. Marie-Hélène Sabard visualise plus des
sixièmes, et vous adresser une séquence pédagogique pour des élèves de
troisième. Comment comprendre ce désaccord ?
Je profite de votre question pour remercier
Marie-Hélène Sabard qui, elle, est traductrice de profession et a su réparer
une grande partie de mes maladresses. On lui doit par exemple l’idée de faire
de l’Oiseau-Hors-Du-temps, une « Oiselle », c’est joli et c’est
cohérent. Pour répondre à la seconde partie de votre question, je vous renvoie
à ce que ce que je disais précédemment. Quand j’ai conçu la séquence, j’ai
immédiatement pensé troisième: pourquoi ? 1/ Les IO invitent à faire
étudier un roman du XXe 2/ Elles mettent aussi l’accent sur le récit d’enfance ‑
notion nébuleuse entre nous ‑ surtout quand on voit qu’à titre d’exemple y figurent
des autobiographie (Sarraute) des romans autobiographiques (Bazin, Gary), des
contes (Amos Oz) ou des récits philosophiques (Calvino). Peter Pan me semble
idéal pour aborder toutes ces notions. Si en outre on accorde foi aux
réflexions de Kundera, dans l’Art du roman, qui déplore les « occasions
manqués » du roman en évoquant le roman onirique et le roman jeu (façon Jacques
le fataliste) on voit que Peter Pan est une œuvre résolument moderne.
Dernier point qui m’a fait préférer les 3e :
la dimension théâtrale du texte. Peter Pan vient d’une pièce de théâtre. Et la
transposition du récit au théâtre est l’un des exercices que l’on recommande en
3e.
Pensez-vous que des jeunes lecteurs français
soient à même de se retrouver, de s’identifier dans une œuvre telle que Peter
Pan ?
Et pourquoi non ? La palette des personnages
offre à chacun le choix d’opter pour son préféré. Je crois que le fossé qui a
pu exister entre les imaginaires du nord et ceux du sud (je paraphrase
vaguement Mme de Staël) est désormais comblé – Merci Disney !
Personnellement j’ai une nette préférence pour Wendy, j’aurais d’ailleurs aimer
redonner au roman son titre initial, Peter and Wendy, mais pour d’évidente
raisons commerciales, l’idée a été écartée. Je ne crois pas que la traducteur
de The Call of the Wild qui avait choisi L’Appel sauvage ait remporté un franc
succès avec ce titre, sa maison d’édition est d’ailleurs revenue à l’Appel de
la forêt. Il y a un peu de nous dans tous les personnages, Clochette est
teigneuse, Peter vaniteux, Wendy fidèle à l’enfance et soucieuse de grandir…
Nous avons été enfant, et confronté à l’impitoyable pragmatisme des adultes.
Peter Pan est une œuvre qui peut toucher tout le monde.
Mes entretiens et enquêtes révèlent que Peter Pan
est une œuvre peu empruntée en bibliothèque, donc peu lues, comment comprendre
cela ? Comment rendre accessible cette œuvre aux jeunes lecteurs ?
Je ne sais pas. En tant que professeur, j’aurai à
cœur de la faire connaître ou intégralement ou par extrait. Aux éditeurs de
faire leur travail, en ce qui concerne la promotion de l’ouvrage. Ce que vous
me dites m’étonne un peu malgré tout car l’œuvre est régulièrement retraduite
et reprise, c’est donc qu’elle doit se vendre. J’ai eu la surprise de constater
par exemple que Payot avait publié, en même temps que sortait ma traduction une
version de Maxime Rovère qui doit être tout à fait intéressante.
A quel niveau situez-vous la complexité de lecture
Peter Pan ?
Ma fille qui l’a lu, s’est dite gênée par les
interventions incessantes du narrateur. Ce mode de narration libre et désinvolte
gêne l’illusion référentielle qu’affectionnent les amateurs de romans. Mais c’est très bien ainsi, la littérature
est aussi faite pour déranger. Par ailleurs, Barrie se moque un peu de son
histoire, je l’ai évoqué dans la préface. Ce qui l’intéresse c’est le jeu mais
quand il s’agit de rapporter les scènes cruciales d’affrontement au danger ou de
combat, il s’en tire par une pirouette.
Vous qui êtes enseignant, comment comprenez-vous
l’absence de Peter Pan sur les listes de
recommandations de l’Education
Nationale ?
V. E. me racontait que sa fille lors des TPE a
travaillé sur Peter Pan. Lors de la présentation de son travail, le professeur
de français lui a rétorqué que Peter Pan n’était pas de la littérature et que
son choix donc n’était pas pertinent pour une filière littéraire. Comment
comprendre un tel rejet ?
Je réponds à vos deux questions en même temps. Nos
institutions scolaires souffrent d’un incroyable « provincialisme ».
C'est-à-dire que, pour elles, la littérature se borne à la littérature
française. Armel Guerne qui fut un grand traducteur stigmatisait déjà cette
tendance dans les années soixante-dix – et c’est à lui que j’emprunte
l’expression. On aurait pu croire que les choses allaient changer avec la
mondialisation, l'identité européenne. Les programmes de collège autorisent quelques incursions dans
les littératures étrangères. Mais au lycée… Regardez l’épreuve dite de
littérature en terminale L, soumise à un programme national, on aurait pu penser que l’on proposerait aux élèves
des œuvres qui sortent des sentiers battus mais au lieu de Barry Lindon nous
avons eu Zazie dans le métro. Lorenzaccio et Madame Bovary, œuvres régulièrement
abordées en première et qui sont à nouveau proposées en terminale. Il m’est arrivé de
faire étudier des œuvres de Shakespeare en 1e, sur une classe de
trente-trois, pas un seul élève n’a été interrogé à l’oral sur la pièce. Il
n’est donc rien d’étonnant à trouver cette réaction chez un professeur de
lycée. On ne peut que lui conseiller la lecture des essais d’Armel Guerne ou
des réflexions de Steiner .
De quelle manière cette œuvre peut-elle être ou
non abordable par les plus jeunes, à l’école élémentaire par exemple ?
Vous me faites sortir de mon domaine de
compétence. On peut peut-être tout simplement la lire à voix haute, non ? Pennac n’est
pas complètement dépassé.
 Un recueil que j'ai trouvé à Exeter me ramène vers ce poète exceptionnel que fut Kathleen Raine : scientifique de formation, elle n'a de cesse de célébrer la beauté du monde y compris dans les pires moments de son existence. Influencée par Blake et Yeats, sa poésie est une méditation à la fois grave et légère sur la condition de l'homme, roseau pensant - je ne sais pas si elle connaissait Pascal.
Un recueil que j'ai trouvé à Exeter me ramène vers ce poète exceptionnel que fut Kathleen Raine : scientifique de formation, elle n'a de cesse de célébrer la beauté du monde y compris dans les pires moments de son existence. Influencée par Blake et Yeats, sa poésie est une méditation à la fois grave et légère sur la condition de l'homme, roseau pensant - je ne sais pas si elle connaissait Pascal.